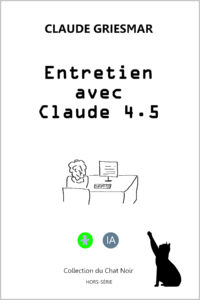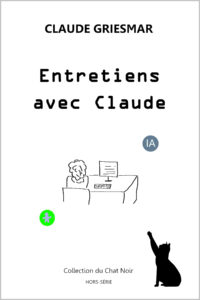Thomas Mann – Tonio Kröger ♥
(Roman / 1903)
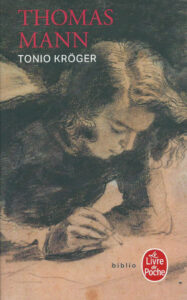
Un roman court, intense et poignant.
Tonio Kröger nait d’une mère méridionale, artiste, éloignée des problèmes matériels du quotidien, et d’un père allemand, bourgeois sérieux, respectable et respecté dans sa ville natale du nord de l’Allemagne.
Tout le drame de la vie de Tonio Kröger vient de cette double influence contradictoire qui se transforme chez lui en mal-être et en questionnements.
Dès son adolescence, ce débat intérieur permanent le fait se sentir différent de ses camarades. De ses racines du sud, il a hérité de l’amour de l’art et du beau, d’un besoin irrépressible de créer lui-même. Il écrit des vers et en même temps trouve cette passion ridicule, parce qu’elle ne correspond pas à l’image du père. Tonio, cheveux et yeux sombres, solitaire, plongé dans ses livres, admire la beauté de son ami Hans d’abord, puis plus tard d’Inge, des blonds aux yeux bleus qui vivent « normalement » : heureux, entourés d’amis, éloignés des questions existentielles.
Dans tout le livre, reviennent des leitmotivs autour de ce tiraillement entre l’introspection douloureuse et le désir impossible à assouvir d’une vie simple, sérieuse mais heureuse.
Thomas Mann s’est inspirée de sa propre vie et de ses propres doutes pour peindre Tonio Kröger. D’où la vraisemblance du personnage à l’âme tourmentée, attiré par son contraire, dans lequel se reconnaîtront celles et ceux qui ont également du mal à s’intégrer dans la société et qui se demandent régulièrement : « La création n’est-elle pas une malédiction ? Ne prive-t-elle pas du bonheur d’une existence simple et sereine ? ».
Il n’est nullement question de placer les artistes au-dessus des communs des mortels, ou inversement, mais de souligner leurs différences. Les uns et les autres ne ressentent pas les choses de la même manière, ne vivent pas la même vie, n’ont pas le même accès au bonheur.
Magnifique et marquant.
Extraits
Celui qui aime le plus est le plus faible, et doit souffrir. (p.45)
Il fallait être bête pour pouvoir marcher comme lui, et alors on était aimé, car on était aimable. (p.63)
Elle devait venir ! Elle devait remarquer qu’il n’était plus là, et sentir ce qui se passait en lui, elle devait le suivre sans bruit, ne fût-ce que par pitié, mettre sa main sur son épaule et dire : « Viens, rentre avec nous, sois content, je t’aime. » Et il tendit l’oreille derrière lui, et attendit avec une anxiété déraisonnable qu’elle vînt. Mais elle ne vint nullement. Ces choses-là n’arrivent pas sur la terre. (p.67)
Le cœur de Tonio Kröger se serra douloureusement à cette pensée. Sentir s’agiter et se jouer en soi des forces merveilleuses et mélancoliques, et savoir en même temps que ceux vers lesquels vous porte votre ardente aspiration demeurent à leur égard dans une sereine inaccessibilité, cela fait beaucoup souffrir. Mais quoiqu’il se tînt solitaire, exclu, et sans espoir devant une jalousie baissée, et qu’il feignît dans son affliction de regarder au travers, il était quand même heureux. Car dans ce temps-là son cœur vivait. Il battait ardemment et tristement pour toi, Ingeborg Holm, et son âme étreignait ta petite personnalité blonde, claire, mutine et quelconque, et se reniait elle-même avec bonheur. (p.68)
Plus d’une fois il se sentit vexé de ce qu’il pût causer avec Magdalena Vermehren, celle qui tombait toujours, de ce qu’elle le comprît, et rît et fût sérieuse en même temps que lui, tandis que la blonde Inge, même lorsqu’il était assis près d’elle, lui paraissait lointaine, étrangère et interdite, car son langage n’était pas le sien ; et malgré tout il était heureux. Car le bonheur, se disait-il, n’est pas d’être aimé : il n’y a là qu’une satisfaction de vanité, mêlée de dégoût. Le bonheur est d’aimer et peut-être d’attraper çà et là de petits instants où l’on a l’illusion d’être proche de la personne aimée. (p.69)
Il ne travaillait pas comme quelqu’un qui travaille pour vivre, mais comme quelqu’un qui ne veut rien faire d’autre que travailler, parce qu’il ne se compte pour rien en tant qu’être vivant, ne veut être considéré que comme créateur, et le reste du temps va et vient, terne et insignifiant, semblable à l’acteur débarrassé de son fard qui n’existe que lorsqu’il est en scène. Il travaillait en silence, enfermé chez lui, invisible et plein de mépris pour les petits écrivains dont le talent n’était qu’une parure de société, et qui, riches ou pauvres, circulaient, sauvages et débraillés, ou bien exhibaient des cravates recherchées, pensaient avant tout à couler des jours heureux en aimables artistes et ignoraient que les œuvres bonnes ne naissent que sous la pression d’une vie mauvaise, que celui qui vit ne travaille pas, et qu’il faut être mort pour être tout à fait créateur. (p.76-77)
C’est bizarre. Quand une pensée s’empare de vous, on la trouve exprimée partout. On la flaire même dans le vent. (p.82)
Voyez-vous, je reçois parfois des lettres de personnes inconnues, des pages de louanges et de remerciements que m’adresse mon public, des épîtres de gens émus, pleines d’admiration. Je lis ces lettres et je me sens touché par ces sentiments chaleureux et maladroits que mon art a éveillés, une sorte de pitié me prend à l’égard de la naïveté enthousiaste qui s’exprime dans ces lignes, et je rougis en pensant combien l’être honnête qui les a tracées serait désenchanté, s’il pouvait jeter un regard derrière les coulisses, si sa candeur pouvait comprendre qu’au fond un homme droit, sain et normal n’écrit, ne joue, ni ne compose… (p.85)
La littérature n’est pas un métier, mais une malédiction, sachez-le. Quand cette malédiction commence-t-elle à se faire sentir ? Tôt, terriblement tôt ; à une période de la vie où l’on devrait encore avoir le droit de vivre en paix et en harmonie avec Dieu et avec l’univers. Vous commencez à vous sentir marqué, en incompréhensible opposition avec les autres êtres, les gens normaux et comme il faut ; l’abîme d’ironie, de doute, de contradictions, de connaissances, de sentiments, qui vous sépare des hommes, se creuse de plus en plus, vous êtes solitaire et désormais il n’y a plus d’entente possible. (p.86)
C’est un fait qu’il n’y a rien de plus silencieux, rien de plus morne qu’un cercle de gens d’esprit que rien n’embarrasse. Toute connaissance est usée et ennuyeuse. Exprimez une vérité dont la conquête et la possession vous ont peut-être procuré une certaine joie juvénile ; on répondra à vos banales lumières par un bref « évidemment »… Ah oui, la littérature fatigue, Lisaveta ! (p.92-93)
Être comme toi ! Recommencer encore une fois, grandir comme toi, droit, joyeux, simple, normal, régulier, d’accord avec Dieu et les hommes, être aimé des insouciants et des heureux, te prendre pour femme, Ingeborg Holm, et avoir un fils comme toi, Hans Hansen, — vivre, aimer, se réjouir, exempt de la malédiction de connaître et du tourment créateur, parmi les félicités de la vie ordinaire !… Recommencer depuis le commencement ? Mais cela ne servirait de rien. Ce serait de nouveau pareil — tout ce qui est arrivé arriverait encore. Car certains êtres s’égarent nécessairement, parce qu’il n’y a pas pour eux de bon chemin. (p.143)
Il réfléchit à ce qu’il pourrait dire, mais il ne trouva pas le courage de le dire. C’était de toute façon comme toujours : ils ne le comprendraient pas, ils l’écouteraient avec étonnement, car leur langage n’était pas son langage. (p.145)
L’auteur et son œuvre
Thomas Mann est né le 6 juin 1875 à Lübeck et mort le 12 août 1955 à Zurich. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1929, il a écrit onze romans, dont Les Buddenbrook : Le déclin d’une famille (Buddenbrooks – Verfall einer Familie, 1901), Tonio Kröger (1903), Altesse Royale (Königliche Hoheit, 1909), La Montagne magique (Der Zauberberg, 1924), Joseph et ses frères (Joseph und seine Brüder, en quatre tomes entre 1933 et 1943), Charlotte à Weimar (Lotte in Weimar, 1939), Le Docteur Faustus (Doktor Faustus, 1947), une trentaine de nouvelles, dont Le petit Monsieur Friedemann (Der kleine Herr Friedemann, 1898), La Mort à Venise (Der Tod in Venedig, 1912), Mario et le Magicien (Mario und der Zauberer, 1930), deux pièces de théâtre et de nombreux essais.
Il est considéré comme un des écrivains majeurs de la première moitié du vingtième siècle.
À découvrir aussi
Laszlo Krasznahorkai – Tango de Satan
Christina Sweeney-Baird – La fin des hommes
Mes écrits
Ainsi a-t-il été (roman)
Mieux vaut très tard que jamais (roman)
39 hommes en galère (nouvelles)
l'R de rien (roman)
J'ai couché (roman)
Un instant d'égarement (roman)
Gris comme la mort (roman)
Entretiens avec Claude (essai)
Entretien avec Claude 4.5 (essai)
Commander en format papier
Commander en format numérique
Acheter en librairie, Au Bonheur des Livres (Strasbourg)
Si vous appréciez mes livres,
faites-le savoir sur Amazon, Babelio, Goodreads, sur vos réseaux et autour de vous !
Vous êtes ma meilleure carte de visite.