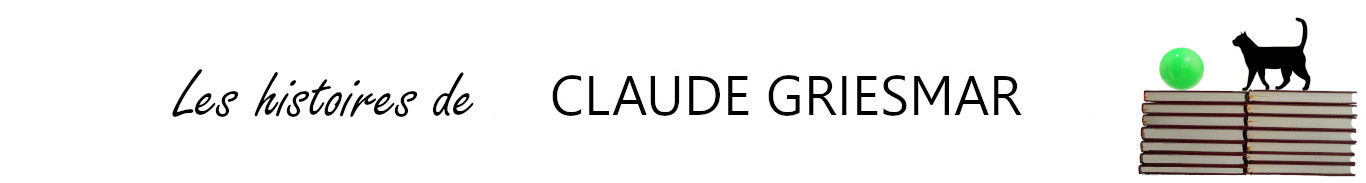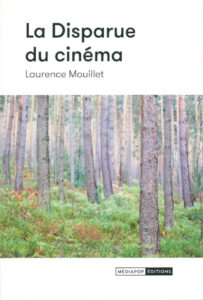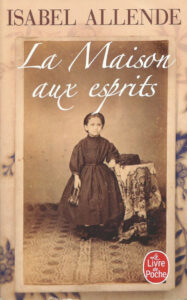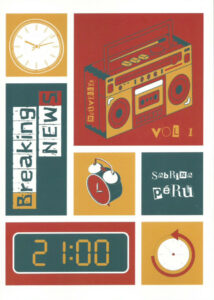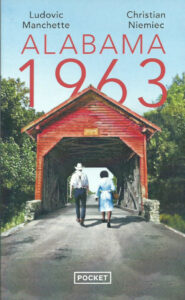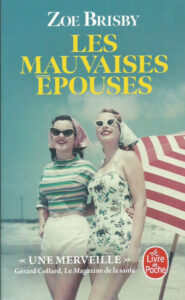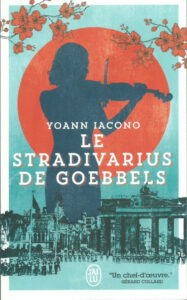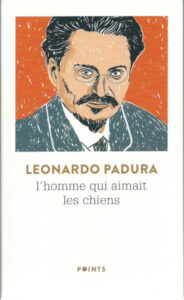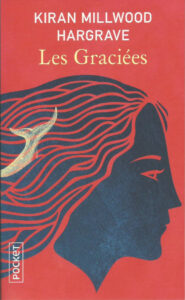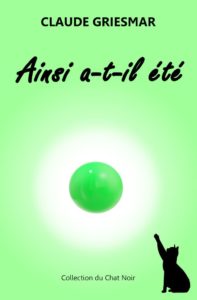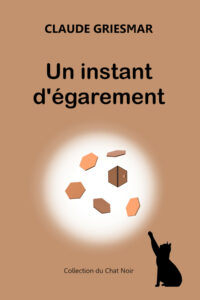RJ Ellory – Une saison pour les ombres
(Roman / 2022 / The darkest season)
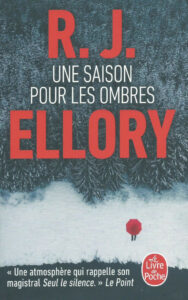
RJ Ellory est un auteur fascinant qui ne m’a jamais déçu.
Les critiques de Une saison pour les ombres évoquent souvent une filiation avec Seul le silence. J’avais découvert RJ Ellory avec ce premier roman paru en France. À l’époque, j’avais noté : « Un roman époustouflant. C’est comme si John Irving au meilleur de sa forme écrivait un roman d’une noirceur absolue. À lire absolument ! » (*) Cette remarque s’applique aussi à Une saison pour les ombres et à bon nombre de ses romans.
RJ Ellory est inclassable. Polar ? Thriller ? Romans noirs ? Quelle serait la bonne case ? Je n’en sais rien. Un mélange de tout ça à la fois, sans doute, et plus encore. Le plus important est que RJ Ellory me régale avec ses histoires toujours renouvelées, son écriture chirurgicale, ses personnages travaillés, ses ambiances sombres. Il me surprend, me tient en haleine, m’instruit, me fait voyager, réfléchir et passer de merveilleux moments de lecture. Il est ma plus belle découverte chez Sonatine que je suis depuis leurs débuts.
De toute façon, Roger Jon Ellory n’a pas vocation à entrer dans une case (non, nous n’avons pas gardé les cochons ensemble RJ et moi, mais c’est comme ça que je me plais à l’imaginer).
Dans Une saison pour les ombres, RJ Ellory explore une fois de plus l’âme humaine, ses faiblesses, ses peurs, ses espoirs, sa noirceur, ses lâchetés, sa capacité à rebondir ou non. Il décortique la force du passé qui empêche de se libérer d’événements, de promesses et de lieux qu’on souhaiterait oublier. Il expose la puissance des superstitions transmises de génération en génération. Il décrit les rouages d’une petite ville coupée du monde, créée par une société minière dans le grand nord du Canada francophone, glacial, inhospitalier. Il raconte la folie qui peut s’emparer des gens en de pareilles circonstances. La folie intérieure mais aussi la folie meurtrière. Parce que, oui, le sang coule. Des jeunes filles meurent. Les autorités manquent de moyens. Tout le monde se voile la face. Un temps. Jusqu’à une énième victime. Jusqu’à la révélation.
RJ Ellory est un conteur exceptionnel.
(*) J’adore John Irving, cette comparaison très personnelle est donc un énorme compliment.
L’auteur et son œuvre
Roger Jon Ellory est né le 20 juin 1965 à Birmingham. Après l’orphelinat et la prison, il devient guitariste dans un groupe de rhythm and blues. Puis il se lance dans la photographie et l’écriture. Il met du temps à trouver un éditeur mais son travail et sa persévérance finissent par payer. Auteur de plus de 20 romans publiés à ce jour, il est reconnu mondialement. En France, son succès a été immédiat avec Seul le silence. Il remporte plusieurs prix littéraires.
Mon RJ Ellory ++
J’ai lu de nombreux romans de cet auteur. Je les ai tous adorés. Chroniques à venir.
À découvrir aussi (clic sur le titre pour en savoir davantage)
D’autres lectures
Fred Vargas – Série « Adamsberg »
Dezso Kosztolanyi – Anna la douce
Mes écrits
Ainsi a-t-il été
Mieux vaut très tard que jamais
39 hommes en galère
l’R de rien
J’ai couché
Un instant d’égarement
Me contacter
Me suivre![]()
Partager