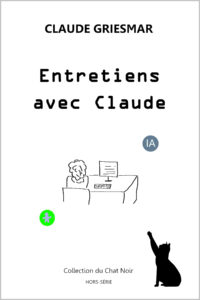Wajdi Mouawad – Anima
(Roman / 2012)

Wahhch Debch découvre sa femme assassinée d’effroyable manière dans son salon. Tétanisé, il part à la recherche du meurtrier, déjà pour se prouver que ce n’est pas lui qui a perpétré cette horreur.
Anima est un roman noir, puissant, déstabilisant, violent et extrêmement original.
Original dans la construction. Wajdi Mouawad part d’un meurtre sordide et de fil en aiguille nous présente la situation peu enviable d’Amérindiens disséminés entre Canada et Etats-Unis, coincés entre coutumes d’un autre temps et réalité du monde actuel, puis l’histoire se transforme en quête. Le personnage principal va à la découverte de lui-même, de son passé oublié et d’événements dramatiques qui l’ont traumatisé durant son enfance. Les révélations se succèdent, le sang coule, le brouillard se dissipe et libère l’Histoire.
Original dans sa narration ensuite. L’histoire est racontée par des animaux qui croisent la route du personnage principal, des chats, des chiens, mais aussi des goélands, des écureuils, des mouches, des araignées et bien d’autres encore (je vous laisse le plaisir de découvrir Tomahawk par exemple). Chaque chapitre est ainsi unique en son genre, selon l’animal qui narre son bout de récit.
En refermant le livre, se pose une question : qui est le plus cruel, l’animal ou l’homme ? Ou non, la question ne se pose pas.
Une œuvre captivante, glaçante, inoubliable.
L’auteur et son œuvre
Wajdi Mouawad est né le 16 octobre 1968 à Deir-el-Qamar au Liban. Réalisateur, scénariste, écrivain, dramaturge, comédien, il a vécu au Liban jusqu’à ses dix ans, puis en France et au Québec.
Mon Wajdi Mouawad ++
Je n’ai rien lu d’autre de cet auteur pour le moment.
À découvrir aussi
Vassili Peskov – Ermites dans la taïga
Leonardo Padura – L’homme qui aimait les chiens
Mes écrits
Ainsi a-t-il été (roman)
Mieux vaut très tard que jamais (roman)
39 hommes en galère (nouvelles)
l'R de rien (roman)
J'ai couché (roman)
Un instant d'égarement (roman)
Gris comme la mort (roman)
Entretiens avec Claude (essai)
Si vous appréciez mes livres,
faites-le savoir sur Amazon, Babelio, Goodreads, sur vos réseaux et autour de vous !
Vous êtes ma meilleure carte de visite.



 Un roman extrêmement touchant.
Le narrateur raconte son expérience dans un Parc royal du Kenya où les animaux sauvages sont protégés de la cupidité et de la bêtise des hommes.
L’histoire de la relation entre un lion et les humains qui l’ont sauvé, bébé. L’histoire d’une jeune fille dont le terrain de jeu est la nature sauvage et ce lion son meilleur ami. L’histoire de la force de cet amour innocent. L’histoire du choc des civilisations entre colonisateurs et colonisés africains. L’histoire des tensions dans une famille dont les membres n’ont pas les mêmes rêves. L’éternelle histoire de la cruauté et de la bêtise des hommes, de ses aspirations, de ses règles, de sa vanité, de ses faiblesses. Ce sont de magnifiques descriptions de paysages et d’animaux aussi.
J’ai été subjugué par ce récit à la fois simple et puissant. A lire au moins une fois dans sa vie.
Un roman extrêmement touchant.
Le narrateur raconte son expérience dans un Parc royal du Kenya où les animaux sauvages sont protégés de la cupidité et de la bêtise des hommes.
L’histoire de la relation entre un lion et les humains qui l’ont sauvé, bébé. L’histoire d’une jeune fille dont le terrain de jeu est la nature sauvage et ce lion son meilleur ami. L’histoire de la force de cet amour innocent. L’histoire du choc des civilisations entre colonisateurs et colonisés africains. L’histoire des tensions dans une famille dont les membres n’ont pas les mêmes rêves. L’éternelle histoire de la cruauté et de la bêtise des hommes, de ses aspirations, de ses règles, de sa vanité, de ses faiblesses. Ce sont de magnifiques descriptions de paysages et d’animaux aussi.
J’ai été subjugué par ce récit à la fois simple et puissant. A lire au moins une fois dans sa vie.
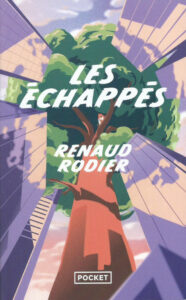
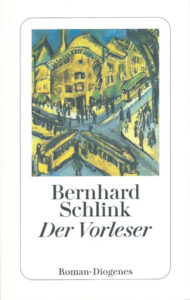 Tout a commencé par une jaunisse pour le narrateur. Ça s’est fini en coup de cœur pour moi. Quelle histoire !
J’avais entendu du bien de cet auteur allemand que je n’avais jamais lu et aussi que ce livre était accessible dans sa langue originale. Lorsque je l’ai vu dans une librairie allemande (oui, il m’arrive de me détendre dans des librairies non francophones, pour l’ambiance), je n’ai pas hésité. Cela faisait tellement longtemps que j’avais envie de relire un livre dans la langue de Goethe. Der Vorleser m’a semblé un candidat idéal. Je ne regrette rien !
J’ai adoré me replonger dans cette langue riche, aux sonorités pleines et si différentes du français. J’ai adoré retrouver des mots puissants, qui n’ont pas d’équivalents chez nous au niveau de leur intensité : Sehnsucht nous emmène loin dans la tête, Heimat prend aux tripes, les deux peuvent briser le cœur et la raison.
J’ai adoré l’histoire surtout.
Je n’avais pas lu la quatrième de couverture et j’ignorais dans quoi je m’embarquais. Bernhard Schlink m’a promené, ému, surpris, crispé, bouleversé. Il est même passé par ma chère Alsace, c’est dire. Si vous souhaitez le lire sans rien en connaître, ce qui m’a très bien réussi et que je ne peux que vous conseiller, sautez le prochain paragraphe.
Pour ceux qui veulent savoir, c’est ici. À quinze ans, le narrateur entretient une relation avec une femme plus âgée que lui. Il la perdra de vue, la retrouvera lors d’un procès concernant la deuxième guerre mondiale. Le roman part d’une jaunisse, passe aux premiers émois amoureux et à ses découvertes et interdits, pour arriver à Auschwitz. Et ce n’est pas tout, mais je ne vais pas tout révéler non plus. En revanche, l’art et la manière avec laquelle l’auteur présente la culpabilité et la honte sont tout simplement admirables. Celles du garçon, de l’homme qu’il deviendra, de celles qui ont mal agi dans les camps, de toute une génération, de toute une nation.
En conclusion, un roman formidable, qui prête à réflexion. Lisez-le, ce Le liseur, si vous ne le connaissez pas. Je vous souhaite d’être secoué et retourné comme je l’ai été.
Des livres de cet auteur à conseiller ?
Tout a commencé par une jaunisse pour le narrateur. Ça s’est fini en coup de cœur pour moi. Quelle histoire !
J’avais entendu du bien de cet auteur allemand que je n’avais jamais lu et aussi que ce livre était accessible dans sa langue originale. Lorsque je l’ai vu dans une librairie allemande (oui, il m’arrive de me détendre dans des librairies non francophones, pour l’ambiance), je n’ai pas hésité. Cela faisait tellement longtemps que j’avais envie de relire un livre dans la langue de Goethe. Der Vorleser m’a semblé un candidat idéal. Je ne regrette rien !
J’ai adoré me replonger dans cette langue riche, aux sonorités pleines et si différentes du français. J’ai adoré retrouver des mots puissants, qui n’ont pas d’équivalents chez nous au niveau de leur intensité : Sehnsucht nous emmène loin dans la tête, Heimat prend aux tripes, les deux peuvent briser le cœur et la raison.
J’ai adoré l’histoire surtout.
Je n’avais pas lu la quatrième de couverture et j’ignorais dans quoi je m’embarquais. Bernhard Schlink m’a promené, ému, surpris, crispé, bouleversé. Il est même passé par ma chère Alsace, c’est dire. Si vous souhaitez le lire sans rien en connaître, ce qui m’a très bien réussi et que je ne peux que vous conseiller, sautez le prochain paragraphe.
Pour ceux qui veulent savoir, c’est ici. À quinze ans, le narrateur entretient une relation avec une femme plus âgée que lui. Il la perdra de vue, la retrouvera lors d’un procès concernant la deuxième guerre mondiale. Le roman part d’une jaunisse, passe aux premiers émois amoureux et à ses découvertes et interdits, pour arriver à Auschwitz. Et ce n’est pas tout, mais je ne vais pas tout révéler non plus. En revanche, l’art et la manière avec laquelle l’auteur présente la culpabilité et la honte sont tout simplement admirables. Celles du garçon, de l’homme qu’il deviendra, de celles qui ont mal agi dans les camps, de toute une génération, de toute une nation.
En conclusion, un roman formidable, qui prête à réflexion. Lisez-le, ce Le liseur, si vous ne le connaissez pas. Je vous souhaite d’être secoué et retourné comme je l’ai été.
Des livres de cet auteur à conseiller ?
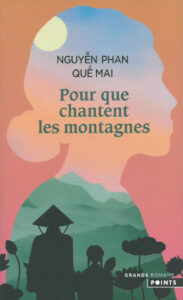
 Le soleil des Scorta a tout pour me plaire. Certainement tout pour plaire.
Commençons par les personnages. Ils ont une personnalité affirmée. Ils expriment une volonté farouche d’aller au bout de leurs idées, même lorsqu’ils se taisent ou n’ont pas idée de ce qu’ils veulent vraiment. Ils affichent du caractère. Ils sont chauds, simples et complexes, droits dans leurs bottes même s’ils sont voleurs ou n’ont pas les moyens de se chausser. Ils sont solidaires, parfois à leur manière. Ils ont le sens de l’honneur. Ils ont le sens de la famille, toujours. Ils sont entiers, surtout. Tous.
Le cadre. Les Pouilles. Le sud de l’Italie. Une région pauvre. Fière. Attachée à sa terre et à ses traditions. Un village de carte postale écrasé sous la chaleur du sud. Un climat qui mène la vie rude à ses habitants. Des villageois qui y naissent et y meurent pour la plupart. Un coin du bout du monde où le curé, représentant de Dieu sur Terre, fait la leçon à ses paroissiens qui écoutent, tête basse. Du moins tant que le curé les comprend et accepte d’être un des leurs. Un lieu hors du temps, qui a toujours été et qui sera toujours. Tant que le soleil y fera pousser des oliviers et que la mer fournira du poisson.
L’histoire. Un amour malheureux qui débouche sur une lignée qu’on méprise, qu’on maltraite, qu’on craint, qu’on aime et qu’on protège quand même, ne font-ils pas partie du village ? Une histoire de famille, d’amour, de transmission. Une histoire universelle.
L’écriture de Laurent Gaudé, enfin. Ciselée, majestueuse, précise, tranchante, émouvante, d’une force évocatrice impressionnante, poétique.
Un roman puissant, bouleversant, inoubliable. Un chef-d’œuvre.
(prix Goncourt, mais c’est si peu important, comparé à la magnificence de ce récit)
Le soleil des Scorta a tout pour me plaire. Certainement tout pour plaire.
Commençons par les personnages. Ils ont une personnalité affirmée. Ils expriment une volonté farouche d’aller au bout de leurs idées, même lorsqu’ils se taisent ou n’ont pas idée de ce qu’ils veulent vraiment. Ils affichent du caractère. Ils sont chauds, simples et complexes, droits dans leurs bottes même s’ils sont voleurs ou n’ont pas les moyens de se chausser. Ils sont solidaires, parfois à leur manière. Ils ont le sens de l’honneur. Ils ont le sens de la famille, toujours. Ils sont entiers, surtout. Tous.
Le cadre. Les Pouilles. Le sud de l’Italie. Une région pauvre. Fière. Attachée à sa terre et à ses traditions. Un village de carte postale écrasé sous la chaleur du sud. Un climat qui mène la vie rude à ses habitants. Des villageois qui y naissent et y meurent pour la plupart. Un coin du bout du monde où le curé, représentant de Dieu sur Terre, fait la leçon à ses paroissiens qui écoutent, tête basse. Du moins tant que le curé les comprend et accepte d’être un des leurs. Un lieu hors du temps, qui a toujours été et qui sera toujours. Tant que le soleil y fera pousser des oliviers et que la mer fournira du poisson.
L’histoire. Un amour malheureux qui débouche sur une lignée qu’on méprise, qu’on maltraite, qu’on craint, qu’on aime et qu’on protège quand même, ne font-ils pas partie du village ? Une histoire de famille, d’amour, de transmission. Une histoire universelle.
L’écriture de Laurent Gaudé, enfin. Ciselée, majestueuse, précise, tranchante, émouvante, d’une force évocatrice impressionnante, poétique.
Un roman puissant, bouleversant, inoubliable. Un chef-d’œuvre.
(prix Goncourt, mais c’est si peu important, comparé à la magnificence de ce récit)

 D’un papillon à une étoile, le premier roman d’Éloïse Riera, est une histoire de voyages.
Un voyage vers les étoiles, sans la distance, sans les années-lumière, sans Kourou ni Cap Canaveral. Un voyage en émotion, avec la plume délicate de l’auteure. Un voyage à la découverte de l’Espagne, rêve d’un père à qui on a annoncé qu’il allait mourir sous peu. Un voyage de reconstruction d’une famille, organisé par une fille du père, qui a envie de recoller les morceaux tant qu’il en est encore temps. Un voyage de révélations, faites les uns aux autres, découvertes en chacun, parce qu’un voyage intérieur aussi pour chaque voyageur. Un voyage vers l’espoir parce que si tout voyage a une fin qui arrive trop tôt, programmée ou tragique, chaque voyage laisse des souvenirs impérissables. Un voyage qui nourrit l’âme. Un voyage pour fêter la famille et la vie.
D’un papillon à une étoile est puissant et poétique, intense et éthéré. On sent que pour écrire ce roman presque intime, Éloïse Riera a puisé de la force et de la sérénité dans une étoile qui compte particulièrement pour elle et qui brille plus que jamais de fierté pour sa fille.
Je ne peux que vous conseiller d’entreprendre ce voyage. Et également de profiter de vos proches, le temps file à une vitesse vertigineuse.
Merci Éloïse Riera pour ce voyage.
D’un papillon à une étoile, le premier roman d’Éloïse Riera, est une histoire de voyages.
Un voyage vers les étoiles, sans la distance, sans les années-lumière, sans Kourou ni Cap Canaveral. Un voyage en émotion, avec la plume délicate de l’auteure. Un voyage à la découverte de l’Espagne, rêve d’un père à qui on a annoncé qu’il allait mourir sous peu. Un voyage de reconstruction d’une famille, organisé par une fille du père, qui a envie de recoller les morceaux tant qu’il en est encore temps. Un voyage de révélations, faites les uns aux autres, découvertes en chacun, parce qu’un voyage intérieur aussi pour chaque voyageur. Un voyage vers l’espoir parce que si tout voyage a une fin qui arrive trop tôt, programmée ou tragique, chaque voyage laisse des souvenirs impérissables. Un voyage qui nourrit l’âme. Un voyage pour fêter la famille et la vie.
D’un papillon à une étoile est puissant et poétique, intense et éthéré. On sent que pour écrire ce roman presque intime, Éloïse Riera a puisé de la force et de la sérénité dans une étoile qui compte particulièrement pour elle et qui brille plus que jamais de fierté pour sa fille.
Je ne peux que vous conseiller d’entreprendre ce voyage. Et également de profiter de vos proches, le temps file à une vitesse vertigineuse.
Merci Éloïse Riera pour ce voyage.
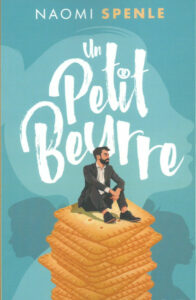
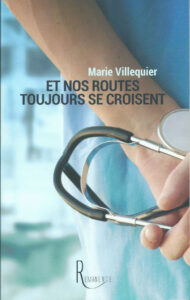 Notre société a la manie presque obsessionnelle de classer les romans dans des cases. Les romances, les polars, la fantasy, la littérature blanche, la science-fiction, les thrillers, le feel-good, les romans historiques, parmi les plus connues. Pratique pour les lecteurs de s’y retrouver, de rester confortablement dans leur zone de confort. Pratique pour les auteurs de pouvoir se raccrocher à des codes du genre et ainsi écrire des histoires sur des schémas déjà éprouvés. Pratique pour les éditeurs pour vendre, cibler les lecteurs, proposer jusqu’à plus soif ce qui est attendu, ce qui se vend, ce qui est à la mode.
Tous les auteurs ne jouent pas le jeu des cases. Heureusement.
Notre société a la manie presque obsessionnelle de classer les romans dans des cases. Les romances, les polars, la fantasy, la littérature blanche, la science-fiction, les thrillers, le feel-good, les romans historiques, parmi les plus connues. Pratique pour les lecteurs de s’y retrouver, de rester confortablement dans leur zone de confort. Pratique pour les auteurs de pouvoir se raccrocher à des codes du genre et ainsi écrire des histoires sur des schémas déjà éprouvés. Pratique pour les éditeurs pour vendre, cibler les lecteurs, proposer jusqu’à plus soif ce qui est attendu, ce qui se vend, ce qui est à la mode.
Tous les auteurs ne jouent pas le jeu des cases. Heureusement.